Hermès dévoilé
(Comment j’ai composé
certains de mes livres)
Troisième et dernière partie :
Alinéas « à la Bordas », lettrines,
colophon, couverture, ligatures

Hermès dévoilé
(Comment j’ai composé
certains de mes livres)
Troisième et dernière partie :
Alinéas « à la Bordas », lettrines,
colophon, couverture, ligatures

À la Bordas !
![]() Là encore, il faut revenir aux débats de la liste Typographie. Le 5 septembre 2000, Thierry Bouche faisait part de son enthousiasme
pour un ouvrage mexicain : Jorge de Buen, Manual de diseño editorial, Editorial Santillana. « C’est beaucoup plus et un peu moins
que le Bringhurst. Le lecteur est pris en main (souvent d’une
façon assez vigoureuse que je trouve plutôt savoureuse) dès le
départ. […] Bref, c’est un livre pragmatique qui aborde l’ensemble
des problèmes à résoudre pour aboutir à la version imprimée d’un
texte achevé. »
Là encore, il faut revenir aux débats de la liste Typographie. Le 5 septembre 2000, Thierry Bouche faisait part de son enthousiasme
pour un ouvrage mexicain : Jorge de Buen, Manual de diseño editorial, Editorial Santillana. « C’est beaucoup plus et un peu moins
que le Bringhurst. Le lecteur est pris en main (souvent d’une
façon assez vigoureuse que je trouve plutôt savoureuse) dès le
départ. […] Bref, c’est un livre pragmatique qui aborde l’ensemble
des problèmes à résoudre pour aboutir à la version imprimée d’un
texte achevé. »
![]() Le lendemain, Thierry Bouche précisait : Jorge de Buen « liste
les différents modes de composition de paragraphes (lire « alinéas »),
dont un impayable mode « Bordas » qui consiste à les mettre à
la suite les uns les autres, en mettant une lettrine qui se retrouve
donc n’importe où dans le pavé pour signaler la coupure. Similaire,
donc au système moyenâgeux, mais en remplaçant ¶ par des lettrines. »
Le lendemain, Thierry Bouche précisait : Jorge de Buen « liste
les différents modes de composition de paragraphes (lire « alinéas »),
dont un impayable mode « Bordas » qui consiste à les mettre à
la suite les uns les autres, en mettant une lettrine qui se retrouve
donc n’importe où dans le pavé pour signaler la coupure. Similaire,
donc au système moyenâgeux, mais en remplaçant ¶ par des lettrines. »
![]() Dans un mail privé, il m’expliquait : « Le truc que Buen appelle
le système de Bordas est très marrant (ça daterait de 70 ans) :
il explique que ça donne beaucoup de flexibilité au typo. Le principe
est de couper en deux parts égales la dernière ligne du paragraphe,
et de commencer le suivant par une lettrine (qui interrompt donc
ces deux demi-lignes) sur deux lignes ; on a donc presque toujours
le choix de couper en deux la dernière ligne ou les deux dernières.
Cela dit, le résultat est — bizarre… »
Dans un mail privé, il m’expliquait : « Le truc que Buen appelle
le système de Bordas est très marrant (ça daterait de 70 ans) :
il explique que ça donne beaucoup de flexibilité au typo. Le principe
est de couper en deux parts égales la dernière ligne du paragraphe,
et de commencer le suivant par une lettrine (qui interrompt donc
ces deux demi-lignes) sur deux lignes ; on a donc presque toujours
le choix de couper en deux la dernière ligne ou les deux dernières.
Cela dit, le résultat est — bizarre… »
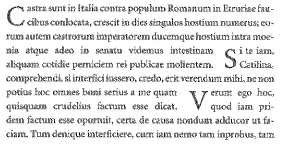
Exemple extrait du livre de Jorge de Buen.
![]() Il est plus que bizarre, il est carrément étrange. Et je ne voyais
pas très bien où est l’élément de souplesse pour le typographe
(mais ça règle définitivement le problème des veuves et des orphelines,
évidemment…) Tout ça me donnait envie d’essayer, et justement
j’avais Hermès en train de mijoter tranquillement : pourquoi ne pas lui ajouter
cette épice ?
Il est plus que bizarre, il est carrément étrange. Et je ne voyais
pas très bien où est l’élément de souplesse pour le typographe
(mais ça règle définitivement le problème des veuves et des orphelines,
évidemment…) Tout ça me donnait envie d’essayer, et justement
j’avais Hermès en train de mijoter tranquillement : pourquoi ne pas lui ajouter
cette épice ?
![]() Quelques essais plus tard, je trouvai le résultat vraiment trop
beau pour être abandonné, malgré le surcroît de travail demandé.
Mais j’ai vite rejeté le principe pur et dur, pour m’orienter
vers une solution coupant le paragraphe en amont sur trois lignes,
et laissant le début de paragraphe sur deux lignes et au fer à
droite, ce qui provoque inévitablement une portion de ligne blanche
au-dessus du départ de paragraphe et pas mal de blanc avec lequel
je pouvais travailler.
Quelques essais plus tard, je trouvai le résultat vraiment trop
beau pour être abandonné, malgré le surcroît de travail demandé.
Mais j’ai vite rejeté le principe pur et dur, pour m’orienter
vers une solution coupant le paragraphe en amont sur trois lignes,
et laissant le début de paragraphe sur deux lignes et au fer à
droite, ce qui provoque inévitablement une portion de ligne blanche
au-dessus du départ de paragraphe et pas mal de blanc avec lequel
je pouvais travailler.
![]() Car il est impossible de « jouer à Bordas », avec ses règles strictes,
dans une justification si étroite, avec un si faible interlignage
et une hauteur de colonne si faible (et encore mon auteur ne fait
presque jamais de paragraphes ; qu’est-ce que ça aurait été s’il
écrivait par fragments… D’où l’idée de subvertir le principe,
de rompre les alignements, de générer du blanc (atténué cependant
par la masse de la lettrine et des petites capitales), etc.
Car il est impossible de « jouer à Bordas », avec ses règles strictes,
dans une justification si étroite, avec un si faible interlignage
et une hauteur de colonne si faible (et encore mon auteur ne fait
presque jamais de paragraphes ; qu’est-ce que ça aurait été s’il
écrivait par fragments… D’où l’idée de subvertir le principe,
de rompre les alignements, de générer du blanc (atténué cependant
par la masse de la lettrine et des petites capitales), etc.
![]() Autre avantage, ma « subversion » du principe de Bordas aide le
lecteur à voir où ils commencent, ces fameux paragraphes (ce qui
est presque impossible avec le système « canonique »). L’inconvénient,
c’est que ça crée une sorte d’habillage qui fonctionne mal quand
le blanc tournant est trop étroit à gauche.
Autre avantage, ma « subversion » du principe de Bordas aide le
lecteur à voir où ils commencent, ces fameux paragraphes (ce qui
est presque impossible avec le système « canonique »). L’inconvénient,
c’est que ça crée une sorte d’habillage qui fonctionne mal quand
le blanc tournant est trop étroit à gauche.
![]() Au total, le résultat m’a paru gai et incohérent.
Au total, le résultat m’a paru gai et incohérent.
![]() Exemple sur une double page :
Exemple sur une double page :
![]() Cela étant, ce principe de Bordas n’est vraiment pas un cadeau
pour l’opérateur, c’est même un cauchemar, et je me demande comment
J. de Buen a pu imaginer que c’était flexible. Ou bien cet auteur est un grand humoriste, c’est possible…
Cela étant, ce principe de Bordas n’est vraiment pas un cadeau
pour l’opérateur, c’est même un cauchemar, et je me demande comment
J. de Buen a pu imaginer que c’était flexible. Ou bien cet auteur est un grand humoriste, c’est possible…
![]() Avec « Bordas », il faut faire tout le temps des choix : à chaque
paragraphe on a plusieurs solutions (au moins deux, l’une avec
une fin de paragraphe longue et l’autre avec une fin de paragraphe
courte, souvent plus).
Avec « Bordas », il faut faire tout le temps des choix : à chaque
paragraphe on a plusieurs solutions (au moins deux, l’une avec
une fin de paragraphe longue et l’autre avec une fin de paragraphe
courte, souvent plus).
![]() Pire :
Pire :
![]() — L’opérateur doit gérer la fin de paragraphe en amont (en face
du « pavé Bordas ») pour ne pas se retrouver avec trois lignes
mal espacées. Du coup, les fins de paragraphe ne sont pas parfaitement
« au carré » (la dernière ligne est presque partout au fer à gauche).
Ça m’a absolument désolé de faire ça, mais je me retrouvais parfois
dans des justifications si étroites que l’interlettrage ou les
espaces inter-mots devenaient démesurés et hideux.
— L’opérateur doit gérer la fin de paragraphe en amont (en face
du « pavé Bordas ») pour ne pas se retrouver avec trois lignes
mal espacées. Du coup, les fins de paragraphe ne sont pas parfaitement
« au carré » (la dernière ligne est presque partout au fer à gauche).
Ça m’a absolument désolé de faire ça, mais je me retrouvais parfois
dans des justifications si étroites que l’interlettrage ou les
espaces inter-mots devenaient démesurés et hideux.
![]() — L’opérateur doit aussi gérer le flot de texte dans le paragraphe
courant. À cause de la lettrine, la ligne supérieure du début
de paragraphe est nécessairement plus longue que la seconde ligne,
ce n’est pas toujours réalisable de façon simple et peut générer
des fausses coupes en aval.
— L’opérateur doit aussi gérer le flot de texte dans le paragraphe
courant. À cause de la lettrine, la ligne supérieure du début
de paragraphe est nécessairement plus longue que la seconde ligne,
ce n’est pas toujours réalisable de façon simple et peut générer
des fausses coupes en aval.
![]() — On notera que si je me suis interdit de faire une césure à la
fin de cette seconde ligne (ce qui aurait été absurde, aussi bien
graphiquement que du point de vue du sens), j’ai été contraint
d’admettre la présence de césure sur la première ligne du « pavé
Bordas ».
— On notera que si je me suis interdit de faire une césure à la
fin de cette seconde ligne (ce qui aurait été absurde, aussi bien
graphiquement que du point de vue du sens), j’ai été contraint
d’admettre la présence de césure sur la première ligne du « pavé
Bordas ».
![]() — L’opérateur doit enfin gérer la suite du texte, la fin du paragraphe !
Car selon le nombre de mots qu’on met dans le « pavé Bordas »
courant, le paragraphe va être lui-même bien ou mal aligné avec
le « pavé Bordas » suivant.
— L’opérateur doit enfin gérer la suite du texte, la fin du paragraphe !
Car selon le nombre de mots qu’on met dans le « pavé Bordas »
courant, le paragraphe va être lui-même bien ou mal aligné avec
le « pavé Bordas » suivant.
![]() Autre problème : que faire des hauts et bas de pages ?
Autre problème : que faire des hauts et bas de pages ?
![]() — J’ai adopté comme principe qu’une page devait se terminer sur
une ligne pleine : ça n’a été presque jamais été possible.
— J’ai adopté comme principe qu’une page devait se terminer sur
une ligne pleine : ça n’a été presque jamais été possible.
![]() — J’ai adopté comme principe qu’une page devait toujours commencer
par une ligne pleine, et ça a été presque toujours possible, mais
avouons-le : c’est que j’ai eu de la chance !
— J’ai adopté comme principe qu’une page devait toujours commencer
par une ligne pleine, et ça a été presque toujours possible, mais
avouons-le : c’est que j’ai eu de la chance !
Lettrines, petites et grandes capitales.
![]() C’est la deuxième fois que j’utilise un système découvert dans
un ouvrage du XVIIe ou XVIIIe siècle : après la lettrine, mettre une grande capitale puis continuer
avec des petites capitales le mot ou le groupe de mots qui suivent.
Il semble que ça a été une pratique très courante, peu à peu tombée
en désuétude.
C’est la deuxième fois que j’utilise un système découvert dans
un ouvrage du XVIIe ou XVIIIe siècle : après la lettrine, mettre une grande capitale puis continuer
avec des petites capitales le mot ou le groupe de mots qui suivent.
Il semble que ça a été une pratique très courante, peu à peu tombée
en désuétude.
![]() Voici ce qu’en écrivait M. D. Fertel (1723), imprimeur et auteur
de La Science de l’imprimeur : « La Lettre qui suit immédiatement la Lettre de deux points, doit être de grande capitale, & le reste du mot en bas de Casse,
& pour un plus bel ornement, on peut le faire de petit capital. »
(Merci à J.-P. Lacroux, qui réprouve le procédé, de m’avoir signalé
cette citation.)
Voici ce qu’en écrivait M. D. Fertel (1723), imprimeur et auteur
de La Science de l’imprimeur : « La Lettre qui suit immédiatement la Lettre de deux points, doit être de grande capitale, & le reste du mot en bas de Casse,
& pour un plus bel ornement, on peut le faire de petit capital. »
(Merci à J.-P. Lacroux, qui réprouve le procédé, de m’avoir signalé
cette citation.)
![]() Je trouve ça joli et marrant. Ça fait enrager (je ne sais pas
pourquoi) certains de mes copains, qui m’en rebattent les oreilles.
Bref, on aura compris que ça relève maintenant de la plaisanterie
plus que d’autre chose.
Je trouve ça joli et marrant. Ça fait enrager (je ne sais pas
pourquoi) certains de mes copains, qui m’en rebattent les oreilles.
Bref, on aura compris que ça relève maintenant de la plaisanterie
plus que d’autre chose.
![]() À noter que j’ai été obligé de grossir la force de corps de la
lettrine, calculée pour Centaur et Dieu sait pourquoi par XPress
de façon à ce qu’elle soit un peu plus petite que la capitale
qui suit (ce qui était très moche !). Mais l’agrandir tout simplement,
ça faisait vraiment trop gras, alors j’ai fait quelque chose qui
ne se fait pas : j’ai un peu étroitisé la lettrine, pour rattraper
optiquement la graisse superflue après agrandissement. J’espère
que ça ne se voit pas trop.
À noter que j’ai été obligé de grossir la force de corps de la
lettrine, calculée pour Centaur et Dieu sait pourquoi par XPress
de façon à ce qu’elle soit un peu plus petite que la capitale
qui suit (ce qui était très moche !). Mais l’agrandir tout simplement,
ça faisait vraiment trop gras, alors j’ai fait quelque chose qui
ne se fait pas : j’ai un peu étroitisé la lettrine, pour rattraper
optiquement la graisse superflue après agrandissement. J’espère
que ça ne se voit pas trop.
Colophon
![]() J’aime les colophons, je n’allais pas me priver… Je continue de
penser que ce témoin de l’histoire du livre, de son texte tout
comme de ses conditions matérielles de fabrication est un des
aspects des plus civilisés de l’art du copiste et du typographe.
On ne peut que regretter sa quasi-disparition, au profit d’un
« achever d’imprimer » sans doute fonctionnel, mais généralement
assez plat.
J’aime les colophons, je n’allais pas me priver… Je continue de
penser que ce témoin de l’histoire du livre, de son texte tout
comme de ses conditions matérielles de fabrication est un des
aspects des plus civilisés de l’art du copiste et du typographe.
On ne peut que regretter sa quasi-disparition, au profit d’un
« achever d’imprimer » sans doute fonctionnel, mais généralement
assez plat.
![]() Pas d’exercice de virtuosité cette fois-ci : j’ai déjà donné (on
peut voir ici quelques exemples). Mais j’en ai profité pour faire une lettrine
marrante, dont j’ai piqué l’idée à une maquettiste rencontrée
autrefois, qui n’aime pas les lettrines et s’est imaginée s’en
débarrasser de cette façon.
Pas d’exercice de virtuosité cette fois-ci : j’ai déjà donné (on
peut voir ici quelques exemples). Mais j’en ai profité pour faire une lettrine
marrante, dont j’ai piqué l’idée à une maquettiste rencontrée
autrefois, qui n’aime pas les lettrines et s’est imaginée s’en
débarrasser de cette façon.
Couverture
![]() Ça faisait un bout de temps que j’avais envie de « tripoter »
la jolie police Galahald, de profiter de son jeu alternate (ah !
le « e » alternate de Galahad…), de créer des ligatures (la police
s’y prête admirablement). C’est un jeu typographique, rien de
plus.
Ça faisait un bout de temps que j’avais envie de « tripoter »
la jolie police Galahald, de profiter de son jeu alternate (ah !
le « e » alternate de Galahad…), de créer des ligatures (la police
s’y prête admirablement). C’est un jeu typographique, rien de
plus.
![]() Toutes les ligatures, ajouts d’accents, etc., ont été créés dans
XPress. Celles de la tranche sont restées comme je les avais réglées :
Toutes les ligatures, ajouts d’accents, etc., ont été créés dans
XPress. Celles de la tranche sont restées comme je les avais réglées :
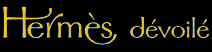
![]() Celles de la première de couverture ont été reprises dans Freehand
(après vectorisation du caractère) et légèrement retouchées :
Celles de la première de couverture ont été reprises dans Freehand
(après vectorisation du caractère) et légèrement retouchées :
![]() Les effets d’embossage, d’ombrage, etc. ont ensuite été créés
dans Photoshop : tout le côté « lissé » des caractères vectoriels
a donc disparu. Ça ne m’a pas paru gênant, on a simplement l’impression
que le texte est peint par-dessus l’illustration.
Les effets d’embossage, d’ombrage, etc. ont ensuite été créés
dans Photoshop : tout le côté « lissé » des caractères vectoriels
a donc disparu. Ça ne m’a pas paru gênant, on a simplement l’impression
que le texte est peint par-dessus l’illustration.
Illustrations
![]() Il existe une grande tradition de l’illustration hermétique. Je
ne voulais pas manquer cette occasion. J’ai donc distribué quelques
gravures, là où le texte m’en laissait la place.
Il existe une grande tradition de l’illustration hermétique. Je
ne voulais pas manquer cette occasion. J’ai donc distribué quelques
gravures, là où le texte m’en laissait la place.
![]() Je ne remercierai jamais assez Olivier Randier et Fabrice Bachella
pour leurs apports en la matière et leurs précieux conseils.
Je ne remercierai jamais assez Olivier Randier et Fabrice Bachella
pour leurs apports en la matière et leurs précieux conseils.
À propos de XPress
![]() J’ai le sentiment qu’avec ce travail, j’ai poussé le logiciel
à sa limite, voire au-delà. Ses défauts, ses faiblesses, m’apparaissent
désormais insurmontables.
J’ai le sentiment qu’avec ce travail, j’ai poussé le logiciel
à sa limite, voire au-delà. Ses défauts, ses faiblesses, m’apparaissent
désormais insurmontables.
Mécénat
![]() J’aimerais bien le voir imprimé, ce livre : il me faudrait un
mécène ;-).
J’aimerais bien le voir imprimé, ce livre : il me faudrait un
mécène ;-).
Lire la deuxième partie : « À propos du gris typographique
et autres aventures (des virgules, des espaces, des accents)… »
Lire la première partie : « Travaux préparatoires, format, empagement et polices »
Retour au sommaire :